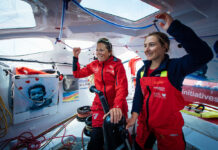Sur la première partie – du golfe de Gascogne aux Canaries – deux situations peuvent se présenter. Premier cas, le plus fréquent à l’automne : un défilé de perturbations avec plusieurs passages de fronts. Cela engendre du vent d’ouest à sud-ouest assez fort C’était le cas voilà quatre ans et cela avait entraîné une mer forte et des abandons en début de course. Le deuxième cas est la situation anticyclonique. Si le centre de l’anticyclone est proche du continent européen, la flotte aura des vents de nord, faibles. Mais si cet anticyclone est au nord ou sur les Açores, il engendrera des vents de nord-est soutenus, donc un départ très rapide.
Au sud des Canaries, on entre dans le domaine des alizés de nord-est, qui tournent à l’est et mollissent à l’approche du Pot au Noir. Marc et les autres devraient être rapides, au portant ou au reaching, bâbord amures. » Il faudra alors penser au point de passage dans la fameuse zone de convergence intertropicale (ZCIT). « Ici s’affrontent les alizés de l’hémisphère nord et de l’hémisphère sud. Les orages se développent rapidement et sont violents : le vent n’est jamais comme il faut. Il y en a parfois trop, jusqu’à 55 voire 60 nœuds… et parfois pas assez avec de longues heures de pétole. Le point de passage est à négocier entre 27° et 33° Ouest, dans le sud du Cap Vert.
Bâbord amures, il faudra alors contourner la dorsale de l’anticyclone de Sainte-Hélène qui peut s’étendre jusqu’au nord du Brésil. C’est la problématique jusqu’aux Quarantièmes rugissants. L’enjeu est de rejoindre le flux perturbé de l’hémisphère sud en contournant cet anticyclone. Dans les cas très favorables, on y parvient vers 35° Sud et dans les moins favorables vers 45° Sud »… soit 600 milles plus “bas” !
Exploiter le flux perturbé en utilisant l’extrémité d’un front qui génère des vents de nord-ouest à l’avant puis de sud-ouest à l’arrière : tout le challenge du contournement de l’Antarctique est là. Une difficulté s’y ajoute : respecter les portes des glaces, ce qui peut, dans certaines situations, contraindre les navigateurs à remonter vers les zones peu ventées.
Dans la remontée de l’Atlantique Sud commencent d’autres grandes difficultés. La plus délicate est la zone de cyclogenèse (naissance des dépressions) au large de l’Argentine. C’est la zone la plus complexe à gérer de ce tour du monde, d’autant qu’après une soixantaine de jours de mer, le skipper est fatigué et le bateau rarement à 100%. Les dépressions se déplacent très rapidement et les modèles de prévision météo ont beaucoup de difficulté à représenter correctement ces systèmes. Les choix de trajectoire sont donc très délicats. L’expérience du skipper prend ici toute sa place, les logiciels de navigation ne sont pas d’une grande utilité. C’est à cet endroit précis qu’on constate que l’homme est plus fort que la machine.
Un des derniers pièges se situe entre la cyclogenèse et le passage de Sainte-Hélène car il y a souvent une zone orageuse. C’est une barrière de plus à franchir avant de reprendre l’enchaînement du début dans le sens inverse : alizés de sud à sud-est, Pot au Noir, alizés de nord-est. Pour finir, il reste à prendre un des trains de dépressions qui circulent sur l’Atlantique Nord afin de rentrer aux Sables. En situation anticyclonique, alors il faudra monter très au nord, quasiment jusqu’en Irlande, avant de pouvoir incurver sa route vers l’arrivée.