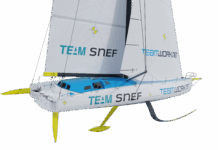Les IMOCA de dernière génération sont dorénavant bardés de capteurs et de fibre optique. Dès la construction, la fibre optique de 250 micromètres de diamètre – à peine plus grosse qu’un cheveu – est intégrée dans les foils, safrans, bras, coques, flotteurs ou gréements, voire les quilles pour les monocoques, et servent à mesurer leur déformation. A l’approche de la première difficulté de ce Vendée Globe, les skippers pourront donc compter sur les alarmes à bord pour limiter le risque de casse.
« Tout ce qui supporte des efforts importants – gréement, appendices – est doté de capteurs et de fibre optique, qui renvoient des informations en temps réel sur ma console de navigation pour être traitées par des logiciels qui me permettent d’avoir la bonne lecture de la situation » nous expliquait Jérémie Beyou, skipper de Charal. A bord, cela peut sonner régulièrement pour avertir le skipper que son gréement est trop sollicité.
Jean-François Cuzon, patron de Pixel sur Mer, a été l’un des tout premiers à la déployer sur les IMOCA. « On utilise cette technologie embarquée depuis 7 ans. On connaissait cela depuis longtemps mais les instruments étaient gros. On a donc développé toute une technique de déploiement de la fibre optique dans des structures composites, et toute la chaîne qui va avec pour traiter la donnée. » La fibre optique permet une mesure très locale, sur quelques millimètres, des déformations du matériel composite.
« Sur une fibre on va avoir plusieurs points de mesure qui vont nous donner une cartographie de la déformation le long de l’appendice du carbone. La mesure est très précise et peu importe les conditions. Il n’y a pas de problème de tenue dans le temps, détaille Jean-François. On intervient assez tôt dans la construction des bateaux parce qu’il y a tout un process d’intégration à gérer. C’est parfois au dernier moment si c’est en extérieur, en mettant la fibre dans des réserves, à l’intérieur de la coque ou du mât. Mais cela peut être mis aussi dans l’avant-dernier pli de carbone, lorsque l’on drape l’appendice pour avoir le maximum d’infos sur la déformation, la fibre pouvant s’intégrer avant cuisson du carbone. »
La fibre optique a plein d’avantages. C’est assez fin et facile à mettre en place. Elle est devenue indispensable pour la sécurité du bateau et de l’équipage, pour analyser la performance en temps réel ou a posteriori, et pour assurer le développement du bateau. Sa seule limite, en dehors de son coût élevé, est qu’elle fournit des données sur un seul axe de déformation. Elle peut ne pas détecter un délaminage si celui-ci est à côté de la fibre. Des nanocapteurs pourraient dans un avenir proche offrir une alternative plus ou moins complémentaire, avec l’avantage d’être plus légers et de mesurer les contraintes dans le temps.
L’usage de la fibre optique a évolué avec le temps et s’est généralisé. Matthieu Robert, directeur de Madintec – qui équipe des Ultime et des IMOCA avec sa centrale Bravo et son pilote automatique –, explique comment la fibre est devenue un maillon sécuritaire essentiel: « Auparavant, on travaillait sur la mesure de charge sur les foils et l’ensemble du bateau – outriggers, étais – pour savoir comment fonctionnait la structure par rapport aux modèles fournis par les architectes lors de la phase de dessin du bateau. La fibre optique était installée pour s’assurer qu’on ne faisait pas de bêtise en navigation. Mais une fois en course, on débranchait les systèmes parce que c’était assez coûteux en énergie : 30 Wh. Avec les nouvelles générations de bateaux, notamment après la Route du Rhum, tout le monde a été d’accord pour avoir ces capteurs en permanence pour éviter de rentrer dans les zones rouges où le bateau risquait de casser. L’idée a donc été d’avoir tout à poste pour donner des alertes au skipper. S’il est trop chargé, qu’il décharge à l’écoute ou à la barre, ou bien que le pilote automatique lofe ou abatte. »
DE LA MESURE à HAUTE FREQUENCE
Mais pour faire de l’analyse en temps réel, il faut d’abord passer par de l’analyse à posteriori, qui permet de définir des modèles informatiques. Et que ce soit pour un besoin sécuritaire, de performance ou de développement continu du bateau, il était devenu indispensable de travailler sur des mesures à hautes fréquences. C’est-à-dire des mesures largement en dessous de la seconde ; la fréquence se mesurant en hertz. On parlera par exemple de 50 hertz pour 50 mesures en 1 seconde.
Sur les anciennes générations d’IMOCA, les données enregistrées se limitaient à la seconde à l’hertz, et les équipes en charge de la performance travaillaient essentiellement sur des phases et des moyennes. « Sur les mesures de vitesses, on travaillait entre 50 et 100 Hz au maximum. Mais on s’est aperçus qu’avec les microdéformations sur les foils, il fallait travailler à plus de 200, voire 500 Hz », précise Matthieu Robert. D’où une avalanche de données à traiter après chaque navigation.
Extrait du Hors Série n°1 de Course Au Large : Tout Savoir des bateaux du Vendée Globe – Actuellement en kiosque